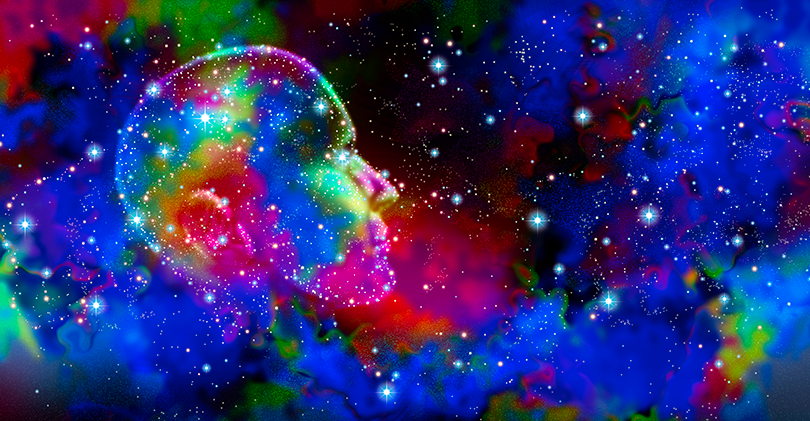Dissertation de Philosophie (corrigé)
La chose est le phénomène indéterminé. Dans sa présence elle serait l’expérience de l’ineffable et de l’obscure. Pour qu’une chose soit « quelque chose » pour le sujet qui l’éprouve, il lui faut un sens et par ailleurs un signe pour renvoyer à ce sens; d’où la nécessité de la nominalisation. Ainsi, la chose advient comme une existence pour un concept. Toutefois, ne serait-ce pas solipsiste de dire que la chose ne peut « être » indépendamment du sujet qui le conçoit ? Que la chose n’ait un sens donné dans l’expérience et qu’il appartient au sujet d’en être à l’écoute plus qu’en être le concepteur ? En somme, comment concevoir que si la chose « est » et que par conséquent si elle a un « en-soi », elle a encore besoin d’être appréciée par le sujet qui l’entend ? Nous allons répondre à ce problème en développant les propositions suivantes. Premièrement, il nous faut observer l’importance du signe comme porteur du concept. Deuxièmement, il faut rencontrer le problème de réduction que les mots imposent à l’existence propre des choses. Finalement, il serait pertinent de proposer comment le concept peut autant évoluer comme l’expérience de la chose.
Partie I : La chose n’est rien sans le signe d’un concept
1. La chose ne peut ne pas être signifiée pour être considérée
Une chose n’est rien sans l’indiquer devant la conscience. Or, Indiquer demande un signe. Fondamentalement un signe est constitué d’un « signifiant » et d’un « signifié ». Le signifiant est le support matériel d’un concept et le signifié est ce concept qui désigne la chose. Considérons par exemple la pierre. La chose de pierre n’est rien sans être saisie dans un signifié. Son signifié est le concept de pierre indiqué par le signifiant qui est la combinaison graphique et phonétique des lettres qui donnent « pierre ». Il semble ainsi impossible d’exprimer, de communiquer ou de même penser la chose sans ce processus de signification. Et comme, il est impossible de la concevoir, elle n’est entre autres rien dans son expérience indéterminée. Aussi, l’indétermination de son expérience ne peut prétendre au statut d’existence, car pour exister il faut bien une saisie de l’entendement. Or, l’entendement n’entend rien sans concept.
2. La chose est concept où elle n’est pas
Mais parlons plus précisément du concept. Certes, la chose est une expérience qui affecte la sensibilité. On ne niera pas que ce qui brûle est brûlant ou pareillement que ce qui est visible est vu. Toutefois, d’où vient cette impression du discernement de l’action de « brûler » et de la qualité du « brûlant » si ce n’est par l’éclaircissement d’une raison qui met de l’ordre dans nos expériences ? Il y a par la raison une faculté de l’ordre dans l’identité et la mesure spatio-temporelle. Sans cet ordre, tout se mélange confusément. Néanmoins, il faut encore attribuer à l’ingéniosité du langage articulé verbalement le véritable exploit organisationnel de toute la puissance de cette faculté de l’ordre. Le langage verbal opère par les signes du substantif pour articuler notre pensée. Si les signes dans leurs premières occurrences n’indiquent que les impressions, ils ont finalement permis le concept par l’abstraction de ces impressions en des connaissances stables et objectives. Par exemple, dans les premiers balbutiements du langage articulé, nos ancêtres n’ont pu indiquer par les signes que les vagues impressions d’une habitude. Mais au fur et à mesure que les signes ordonnèrent l’expérience par différents états, comme l’unité de la substance par le nom, son action ou son état par le verbe et sa qualité ou sa disposition par l’adjectif, la pensée a pu commencer à y définir des propriétés constantes. La chose devient alors cette structure complexe de propriétés identifiables et rationnellement opérables qu’est le concept.
L’existence des choses ne peut donc être clairement saisie que par le signe qui indique sa conception. Toutefois, cela veut-il dire que l’expérience des choses en elles-mêmes ne puisse déjà signifier ?
Partie II : Le concept trahit l’existence propre de la chose
1. La chose « est » indépendamment de ce que l’on dit d’elle
Tout d’abord, hâtons-nous de prévenir le solipsisme. Le solipsisme est une position métaphysique qui prétend affirmer que rien n’existe en dehors de soi et de ses expériences conscientes. Le problème est que le solipsisme ne reconnaît pas les choses qui produisent ces expériences. Que le monde paraisse concret, il se pourrait que ce ne soit qu’une pure construction de l’esprit. Le phénoménologue Husserl dément cette perspective en observant que toute conscience est intentionnalité ou plus simplement que « toute conscience est conscience de quelque chose ». Il est déjà clair par le cogito cartésien que ce « je » qui pense existe mais encore que ce qui est présent à ma pensée ne peut pas ne pas être, car cette « chose » comme mon existence s’est imposée. Il doit bien y avoir une chose qui produit son expérience et par ailleurs si cette chose m’affecte, le signe qui désigne la chose désigne donc une affection et non une pure construction mentale. Il s’ensuit dès lors que si la signification vient d’une affection, les choses existent déjà avant de les signifier et conditionnent même cette signifiance. Husserl va même parler de « connaissance directe » comme le fondement nécessaire de nos connaissances. Il faut considérer par là que la démonstration montre qu’elle doit bien commencer quelque part dans l’indémontrable qui s’impose de lui-même. Or, qu’est-ce quelque part qui s’impose de lui-même sans démonstration sinon ce que l’on ne peut nier comme expérience en dépit de tout doute parabolique ?
2. Le signe trahit la richesse de l’expérience de la chose
Si la chose est donc bien là, car elle s’impose comme expérience, il y a ce problème que les expériences dans leur confusion peinent à rendre quelque chose de définitif. En fait, si l’expérience est changeante et multiple, c’est dans sa nature même. Le problème de la confusion vient du concept qui ne peut fondamentalement la saisir. Le philosophe de l’intuition Henri Bergson propose une vision pertinente au sujet d’un réel insaisissable par la seule description des mots. Il appelle cette réalité l’ « élan vital » ; un réel que nous ne pouvons vivre que par l’expérience du vécu. Selon les idées du philosophe, l’élan vital est un flux continu de création. En ce sens, le réel crée incessamment des particularités. Par exemple, le moment où j’écris n’est qu’une fixation de la mémoire qui reconnaît la continuité de mes mouvements, mais ce véritable moment en temps réel est à jamais perdu dans la particularité ineffable de ses circonstances. Chaque moment est unique dans la complexité particulière de sa composition. Dès lors, les mots trahiraient en quelque sorte les choses, car ils généralisent ces derniers dans des concepts abstraits, ce qui réduit la richesse de leur expérience. On nomme les personnes par leur nom et on les désigne dans des stéréotypes sociaux culturels. Mais qui sont véritablement ces personnes quand ils ne répondent plus à une description type ? On dit souvent que les exceptions confirment les règles. Pourtant, il faut reconnaître que les règles réduisent parfois la riche appréciation d’une personne en lui-même qui comme chacun découvre et évolue.
On peut considérer que la chose existe indépendamment de son signe. Par ailleurs, il faut encore reconnaître la nature indéterminée de la chose sans le signe. Car impression ou pas de la chose, pouvons-nous véritablement observer l’évolution de ces impressions sans l’économie des mots qui les rappelle et permet de raffiner leur conception ?
Partie III : Le concept évolue avec la chose
1. Ce n’est pas que la chose n’existe pas, mais plutôt que son existence est obscure sans l’examen rationnel de ses concepts
La chose existe en dehors de soi par l’impression qu’elle laisse et qui a produit son identification. Cette identification ne réussit pas toujours quand on se trompe de choses. On peut alors se dire que s’il n’y a aucune consistance dans les signes tant elles se contredisent souvent dans leur fonction d’identification. Cependant, c’est vite oublier que le signe évolue avec le concept et que ce dernier évolue avec l’examen rationnel. Or, la condition de la raison comme faculté est justement d’avoir des concepts à opérer. Raison de plus de vouloir signifier que les impressions sont trompeuses pour pouvoir les organiser. Dans cette perspective, les mots font l’économie des informations. Il serait du génie de toujours vouloir se référer à des impressions ou à des sentiments pour ajouter, soustraire, diviser et ainsi de suite pour discerner les états de ces derniers. Il nous faut la formalité économique des mots pour éviter cette « opération par recollections » qui s’avère titanesque. N’importe quels artistes, critiques d’art ou philosophes qui font l’éloge de l’expérience sensible, des sentiments et des intuitions sont toujours redevables de l’avènement du langage verbal qui finalement conditionne la précision de leur concept.
2. Le concept évolue avec l’expérience
Enfin, le mot que nous avons vu avec Bergson généralise la chose. Or, il s’agit d’une réduction de la capacité de son concept à évoluer par la dialectique de ce dernier avec son expérience. En fait, il faut retenir dans la conceptualisation qu’il s’agit d’une ouverture intellectuelle plus que d’une fermeture. Si le concept laisse aux mots l’initiative de la précision, ce n’est pas qu’il se ferme dans une radicalité, mais définit plutôt des contours contextuels liés aux différentes impressions de la chose. La chose par ses différentes expériences renvoie à différentes impressions. Comme nous l’avons vu pour chaque impression, il y a un signe qui conduit à une interprétation conceptuelle. Cela arrive quand un concept ne répond plus aux nouvelles impressions de l’expérience de l’évolution de la chose. Or, les extensions conceptuelles s’imposent et peuvent au final devenir de nouveaux usages. Auparavant, l’étymologie du mot « travail » atteste que son concept initial avait une dénotation négative dans le latin « tripallum » qui s’en remet à un instrument de torture. L’expérience de l’effort du labeur aura tant laissé l’impression de la peine et de la douleur qu’elle fut assimilée à celle de la torture. Toutefois, l’expérience de la croissance économique aura redéfini son concept de nécessité mécanique de production à l’idée d’une libération technique. L’idée du travail comme « nécessité pénible » a trouvé dans l’expérience de l’évolution technique des moyens de production qui ont entraîné une croissance économique sans précédent, la connotation de « produit de la technique » jusqu’à rencontrer l’idée d’une « libération » vis-à-vis de la nature par l’ingéniosité humaine. Il y a aussi donc dans les mots une ouverture à la créativité du concept comme il y a dans les choses une évolution.
Conclusion
En résumé, dans la rencontre du problème de signification qui opposait la signification de la chose en soi et la nécessité du concept pour la rendre existante pour l’entendement, on a cheminé à travers les propositions suivantes. Il nous est d’abord apparu que la chose ne pouvait certainement être considérée comme significative pour l’entendement sans le signe d’un concept, soit sans les mots. Que cela nous garde du solipsisme qui est une métaphysique sans fond, car il faut bien reconnaître que la chose « est » dans toute sa richesse indépendamment d’un sujet qui le représente conceptuellement. L’expérience du vécu semble pertinente dans la mesure où les choses évoluent constamment. Cependant, il faut aussi se garder de l’antirationalisme dans l’excuse d’une conceptualisation à la poursuite d’un infini qui sera toujours insaisissable. Si poursuite il y a, c’est qu’il y a bien des traces dans les impressions. Et, si les impressions évoluent alors pareils sont les concepts qui s’étendent ou se reforment.